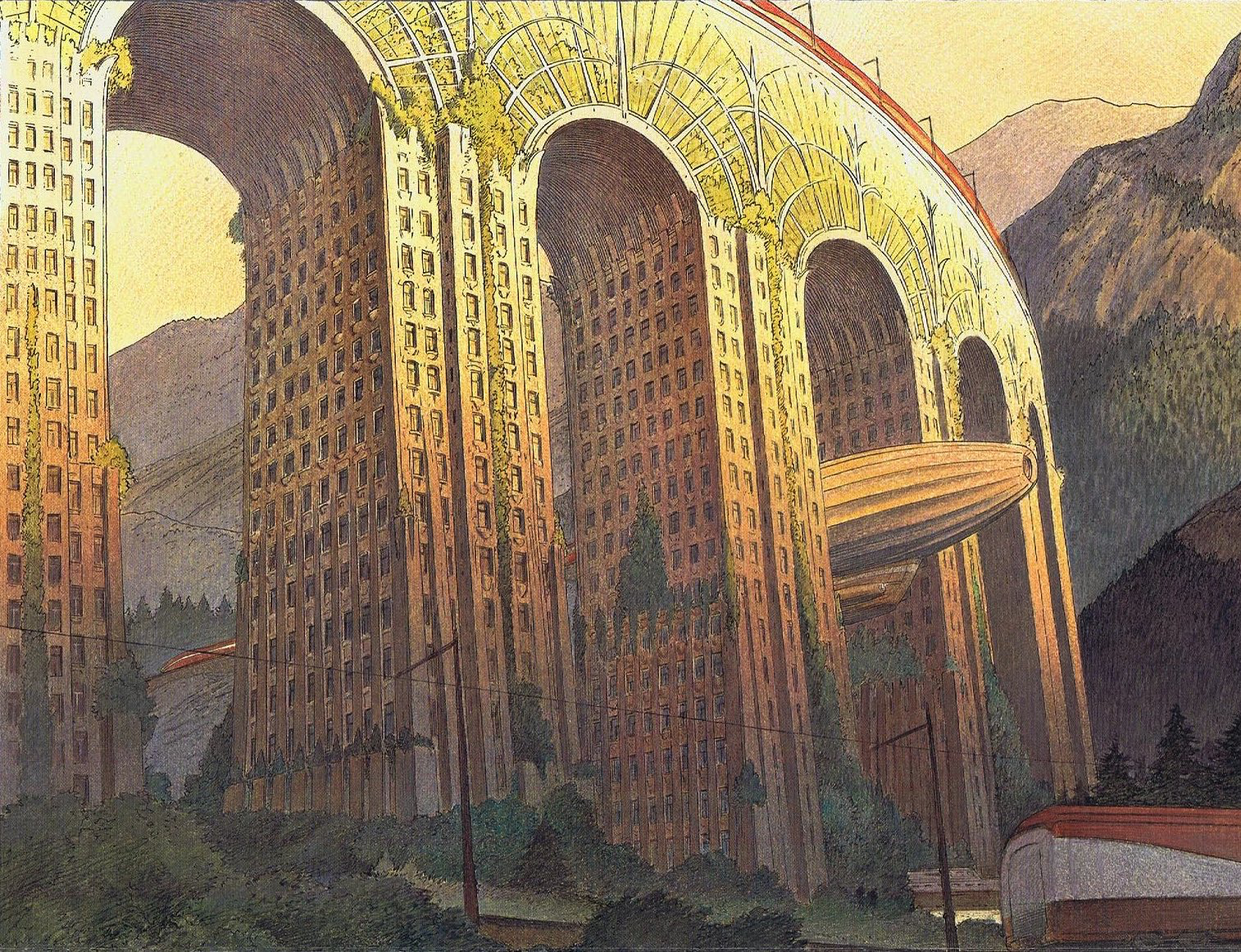Alexandra de Hoop Scheffer, diplomate : « Dans le logiciel américain, l’Europe est de moins en moins présente »
Alexandra de Hoop Scheffer dirige le bureau parisien du German Marshall Fund, une institution qui défend des relations équilibrées entre l’Europe et les États-Unis. Avant le 75e sommet de l’Otan, qui se tient du 9 au 11 juillet à Washington, cette Franco-Néerlandaise observe, non sans inquiétude, le décrochage des Européens.
Recueilli par Olivier Tallès et Pierre Sautreuil, le 03/07/2024 à 16:39. Lecture en 10 min.
La Croix L'Hebdo : Une partie de votre tâche à la tête du bureau parisien du German Marshall Fund consiste à jouer un rôle de médiateur entre la France et ses alliés. Comment nos voisins et partenaires européens ont-ils perçu les résultats des européennes en France et l'annonce de nouvelles élections ?
Alexandra de Hoop Scheffer : Mon téléphone ne cesse de sonner à ce sujet. J'ai énormément de questions de la part de nos partenaires européens et américains, qui s'inquiètent de la situation politique en France, mais aussi en Allemagne, marquée par la défaite de la coalition du chancelier Scholz aux européennes. Le résultat du scrutin européen entérine la crise du couple franco-allemand et l'affaiblissement de ses dirigeants politiques. Il pousse nos voisins à s'autonomiser par rapport aux deux poids lourds de l'Europe et accélère la reconfiguration du paysage européen qui était en cours. Le premier ministre polonais a d'ailleurs indiqué, après l'annonce de la dissolution en France, que cette décision faisait peser sur les épaules de la Pologne une responsabilité de plus en plus grande quant à l'avenir de l'Union européenne.
Quel sera l'impact du scrutin sur le poids de la France au sein des Vingt-Sept ?
A. de H. S. : Nos voisins nous percevaient déjà comme un pays en proie à une instabilité chronique, du fait de l'absence de majorité absolue. La prochaine Assemblée risque d'être encore plus morcelée et de déboucher sur une probable cohabitation. Les élites politiques allemandes se trouveront confortées dans leur diagnostic d'une France en phase de décrochage.
Cela les poussera à court-circuiter davantage Paris et à forger des alliances avec d'autres pays européens. La France aura plus de difficultés à faire passer ses idées à l'échelle européenne, à un moment où Emmanuel Macron avait réussi à prendre les rênes de la politique de soutien à l'Ukraine.
Deux jours après le second tour des législatives, s'ouvrira à Washington le sommet de l'Otan. Vous qui étudiez depuis deux décennies la relation transatlantique, comment diriez-vous qu'elle se porte aujourd'hui ?
A. de H. S. : Elle est confrontée à une double polarisation. On assiste d'une part à l'émergence de blocs, d'alliances et de contre-alliances. La relation États-Unis-Chine est devenue le facteur structurant de tous les autres aspects des relations internationales. Et la deuxième polarisation est d'ordre d'interne, avec la poussée des extrêmes en Europe et aux États-Unis. Le paquet d'aide américain à l'Ukraine a ainsi été littéralement pris en otage pendant six mois, pour des questions de politique intérieure, à cause de la minorité trumpiste. Ces facteurs ont des conséquences directes sur les possibilités de coopérer.
La guerre en Ukraine n'a-t-elle pas souligné le décrochage de l'Europe vis-à-vis de Washington ?
A. de H. S. : L'invasion russe de l'Ukraine a en effet révélé la profonde dépendance des Européens aux États-Unis et à leur garantie de sécurité. C'est le retour du gendarme américain sur le Vieux Continent, du fait de l'incapacité des Européens à assurer leur propre sécurité. Ce retour s'effectue contre son gré d'ailleurs, car l'obsession des États-Unis reste d'abord la Chine, considérée comme la principale menace à moyen et long termes. L'Europe, de son côté, est en train de décrocher sur tous les aspects par rapport aux États-Unis : technologique, économie, transition verte, militaire...
Je vis au quotidien cette forme de déséquilibre constant dans la relation transatlantique. J'observe un leadership américain prédominant et une Europe qui a très peu de marge de manoeuvre pour véritablement se faire entendre. Le constat étant posé, cela ne doit pas nous empêcher de renforcer le pilier européen au sein de la relation transatlantique. La tendance américaine est de nous dire que nous, Européens, nous devons prendre notre destin en main en augmentant nos capacités de défense.
Comment rééquilibrer cette relation ?
A. de H. S. : Je peux vous dire que lorsque l'administration américaine, que ce soit Biden, Obama ou Trump, voit un représentant de l'Union européenne ou d'une capitale européenne qui vient avec des propositions, voire qui met au défi la vision de Washington, celui-ci renforce sa crédibilité face aux Américains. Ça ne leur plaît pas toujours, et d'ailleurs la France est un des pays qui parlent le plus fort en la matière, mais je trouve que c'est très sain d'avoir ce dialogue franc et direct avec notre partenaire américain.
Alexandra de Hoop Scheffer / emmanuelle marchadour / emmanuelle marchadour
En quoi votre travail au German Marshall Fund participe-t-il à l'amélioration de cette relation transatlantique ?
A. de H. S. : Nous sortons du court-termisme et des crises pour mettre sur le radar des autorités politiques, militaires et économiques des questions, des enjeux qui aujourd'hui ne sont pas aussi aigus que les guerres en Ukraine et à Gaza, mais qui pourraient le devenir d'ici quelques mois ou quelques années. Notre seconde mission est de réunir autour de la table des acteurs qui comptent - politiques, industriels, société civile, universitaires - afin de croiser les regards et de faire avancer la conversation sur les sujets clés. Je suis aussi en constant dialogue avec ceux qui prennent des décisions au plus haut niveau politique, militaire et privé.
Pour donner un exemple, juste après Aukus(accord de coopération entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, au détriment de la France, NDLR), qui a beaucoup marqué la relation franco-américaine, j'ai été mobilisée pour être une actrice de la diplomatie de réparation. J'ai pu avoir des discussions très directes, parfois assez brutales, avec des membres de l'administration Biden, afin d'expliciter les ressorts de cette crise et la manière dont la France avait vécu cette décision. Il s'agit d'un travail de médiateur et de facilitateur de dialogue.
Ce dialogue entre Européens et Américains est-il devenu plus difficile ces dernières années ?
A. de H. S. : On s'inquiète beaucoup du retour de Trump au pouvoir mais on néglige le scénario d'un Biden-bis. Si je fais le bilan de sa présidence, c'est le retrait précipité et chaotique d'Afghanistan avec finalement très peu, voire aucune consultation avec les alliés européens, puis l'épisode Aukus. Vous avez ensuite une série de décisions sur le plan économique et technologique qui s'inscrivent dans le cadre de la compétition avec la Chine, mais sans que la Maison-Blanche prenne en compte à aucun moment les intérêts européens, ni n'engage de discussions en amont sur le risque que cela comporte de fragiliser l'Europe. Dans le logiciel américain, l'Europe est de moins en moins présente.
À l'inverse, depuis Barack Obama, on observe une pression grandissante sur les industries et les entreprises européennes afin qu'elles s'alignent sur la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Le champion des semi-conducteurs aux Pays-Bas subit ainsi une pression énorme pour cesser d'exporter certaines technologies dites « très sensibles ». Quand Joe Biden dit que l'Amérique est de retour, il a un agenda très précis de réindustrialisation et d'investissement dans les infrastructures et la tech. Il rassure les Européens sur son soutien mais en échange, et de façon de moins en moins subtile, il demande un soutien contre la Chine, notamment dans le cadre de l'Otan.
Vous vous présentez comme un acteur neutre mais finalement, vous défendez la vision française...
A. de H. S. : Je suis profondément, viscéralement française. J'étais au King's College de Londres en 2003 dans le cadre de mon année d'échange de Science Po. Jacques Chirac y était présenté comme l'homme qui avait résisté à l'Amérique. J'étais complètement aligné sur cette position, qui était la mise en oeuvre de l'idée d'autonomie stratégique, politique et diplomatique. Pour avoir grandi à New York, j'ai compris très jeune les divergences culturelles et de vision du monde que portent les États-Unis et la France, mais en même temps, notre profonde complémentarité. Et c'est donc ce sur quoi je travaille. Il n'y a rien de pire que d'arriver devant un responsable américain et de lui dire : « Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. » À mon grand regret, la France se trouve souvent seule dans cette posture de défier les États-Unis en tant qu'allié. L'Allemagne ne nous suit pas du tout, du fait de sa relation de dépendance militaire.
La France se targue d'avoir la bonne posture, de bonnes idées, de bons concepts en matière stratégique, mais reste souvent isolée. Comment expliquez-vous cette incapacité à communiquer sur ses concepts ?
A. de H. S. : Il y a un problème de méthode. On pourrait davantage s'inspirer de l'Allemagne, qui sait construire et travailler en coalition, parce qu'elle est elle-même une coalition. Ce n'est pas simple, il faut s'entourer, créer une constellation de partenaires, ce qui demande beaucoup de travail, de temps, de rencontres, de pouvoir de conviction. En France, traditionnellement, on pense qu'il suffit de faire un beau discours à la Sorbonne ou ailleurs, et que l'ensemble de nos partenaires européens vont le comprendre et y souscrire, ce qui est faux.
Nous n'investissons pas assez dans notre stratégie partenariale. Je ne crois pas du tout à une Europe à 27 sur tous les sujets. Il faut peut-être revoir à la baisse certains projets, par exemple de coopération industrielle avec l'Allemagne, et au moins essayer d'aboutir à des résultats concrets.
Tout le monde parle de souveraineté européenne de la défense, mais on constate que, depuis 2022, nos alliés en Europe se sont précipités sur le matériel américain, qui représente 70 % des achats d'armes des Européens. Comment expliquez-vous cette frénésie d'achat ?
A. de H. S. : L'industrie de la défense européenne, après des années de désinvestissement chronique, n'est pas capable de fournir, à la cadence que requiert la guerre en Ukraine, les munitions, les obus, les chars... Dans ce contexte d'urgence, on se tourne là où il y a de la disponibilité, c'est-à-dire l'industrie de défense américaine, mais aussi la Corée du Sud et la Turquie pour les drones. Le discours français, qui est de donner la priorité à l'industrie européenne, est tout à fait juste, mais il s'agit d'un projet de moyen et long termes. Acheter américain, c'est aussi une manière pour la grande majorité des pays européens de faire plaisir au Pentagone, qui espèrent s'offrir ainsi la garantie de sécurité américaine.
Alexandra de Hoop Scheffer présente Transatlantic Trends 2023, la publication phare du German Marshall Fund of the United States (GMF), qui fournit aux décideurs politique une analyse approfondie et complète de l'opinion publique sur les questions politiques, tendances économiques et stratégiques. / emmanuelle marchadour / emmanuelle marchadour
Donald Trump s'est montré très critique vis-à-vis de l'Otan. Croyez-vous possible un retrait en cas de victoire ?
A. de H. S. : Je n'y crois pas du tout, et d'ailleurs l'équipe autour de lui ne soutient pas cette idée. Il s'agit d'une tactique de déstabilisation des alliés européens. L'Otan est un outil de pression de luxe que Donald Trump ne lâchera pas demain. Tout comme l'aide à l'Ukraine ne s'interrompra pas. De grosses boîtes de la défense américaine se rendent à Kiev pour signer des contrats.
On peut s'attendre en revanche à un scénario de crise, dans le voisinage est ou sud de l'Europe, où les États-Unis nous diraient : « Ce n'est pas notre intérêt vital. C'est à vous de gérer. » Les États ont beau acheter américain, cela ne leur garantira d'aucune manière le déclenchement de l'article 5 de l'Otan (une attaque contre un des membres déclenche la riposte des autres, NDLR) dans le cas, par exemple, où la guerre en Ukraine déborderait sur le reste du continent.
On a parfois le sentiment que les Américains aident l'Ukraine à reculons...
A. de H. S. : Ce qu'ils ne veulent pas, c'est le risque d'un engagement militaire massif. Les délais s'allongent de plus en plus dans la livraison d'armements à l'Ukraine, car les stocks sont préservés en vue d'un hypothétique conflit avec la Chine autour de Taïwan. Dans les discussions préparatoires au 75e sommet de l'Otan qui se tiendra du 9 au 11 juillet à Washington, les Américains veulent poursuivre et institutionnaliser l'aide aux Ukrainiens, mais ils ne leur proposeront pas de manière explicite une place de membre au sein de l'Alliance.
Ils poussent les Européens à signer des accords de sécurité bilatéraux avec Kiev mais ont paraphé le leur après les autres. Concernant l'aide militaire, ce sont les Européens qui ont proposé de livrer des avions de chasse et des missiles longue portée, surmontant la réticence du président Joe Biden. Ni lui, ni Donald Trump ne veulent que les États-Unis se trouvent impliqués directement dans ce conflit. Je pense toutefois que les Américains enverront des armes plus sophistiquées et à plus longue portée le jour où les Russes parviendront à enfoncer les lignes de défense ukrainiennes.
À vous entendre, on a le sentiment que l'Otan est finalement moins un atout qu'une faiblesse en matière de défense européenne...
A. de H. S. : L'Otan est une énorme machine à faire travailler et coopérer les armées d'une trentaine de pays, ce qu'aucune autre organisation ne permet. Cette interopérabilité est un vrai luxe. Mais il est vrai que l'organisation est façonnée par les priorités stratégiques des États-Unis du fait de leur poids politique, militaire et financier. Je pense que Paris n'a pas suffisamment utilisé les leviers dont il dispose au sein de l'Alliance pour renforcer cette idée de pilier européen de la défense. Renforcer les capacités européennes, ce n'est pas affaiblir l'Otan, bien au contraire. J'observe d'ailleurs que la France a décidé de réinvestir davantage la structure otanienne en y envoyant ses militaires et diplomates.
Votre oncle a été secrétaire général de l'Otan (2004-2009). Est-ce de là que vient votre appétence pour les questions de défense ?
A. de H. S. : Je suis née au Danemark. J'ai grandi à New York, au Benelux, en Scandinavie. Ces voyages m'ont donné envie de décrypter les visions des uns et des autres. J'ai été très tôt intéressée par la diplomatie et les enjeux géopolitiques. Mais c'est la crise irakienne qui m'a vraiment marquée. Comment était-il possible d'engager des troupes sur un terrain complexe pour une cause aussi mal définie ? J'ai d'ailleurs manifesté contre la guerre en Irak à cette époque.
Que pensez-vous à ce propos des manifestations à Sciences Po contre l'intervention israélienne dans la bande de Gaza ?
A. de H. S. : Le blocage d'une université ou d'un lieu où on est censé étudier l'art du débat est contreproductif. Au contraire, Sciences Po doit servir de forum, de cadre de débat, y compris sur les sujets les plus difficiles. Je l'ai toujours connu comme un écosystème entre les étudiants, le corps enseignant et la direction. On l'appelle la maison et c'est ma maison. Entre 2000 et 2011, j'y ai étudié, passé ma thèse et enseigné. L'objectif de Sciences Po n'est pas d'attiser les débats mais de revenir au coeur des discussions et de rétablir une forme de réconciliation entre les étudiants et le corps enseignant. Science Po s'est trop internationalisé. Les étudiants peuvent être diplômés sans avoir suivi un cours en français. Cela ne va pas dans le sens du soutien à l'influence française.
----
Une citation
« Ne soyez jamais assez stupide pour ne pas vous entourer de personnes plus intelligentes que vous. »
« C'est une citation d'Andrew Carnegie (industriel et philanthrope, NDLR) que j'ai découverte en visitant sa maison d'enfance en Écosse. Il manque aujourd'hui des leaders capables de s'entourer de gens qui portent un regard critique sur leur action. »
Une couleur
Le vert
« Celui de Giverny, qui change de spectre au fil des saisons ; celui de l'Écosse, très sauvage, poétique. Dans la famille, nous partons régulièrement nous mettre au vert. Je suis une grande marcheuse et les enfants nous suivent, avec énergie et curiosité. Le contact avec la nature reste fondamental pour compenser la pierre de notre quotidien. »
Un instrument
Le piano
« Depuis très jeune, le piano occupe une part importante dans ma vie. Je joue quatre ou cinq fois par semaine. Je revisite en ce moment les Nocturnes de Chopin, que je redécouvre selon mon humeur du moment. Le clavier demeure un sas de décompression. »
Ses dates
1982 Naissance à Copenhague, au Danemark.
2000 Entrée à Sciences Po.
2007 Parution de Hamlet en Irak (CNRS Éditions, 160 p., 18 €).
2009 Conseillère sur la relation transatlantique au centre d'analyse et de prévision du ministère des affaires étrangères.
2012 Directrice au bureau parisien du German Marshall Fund (GMF).
2021 Senior vice-president du GMF, comité exécutif du GMF.