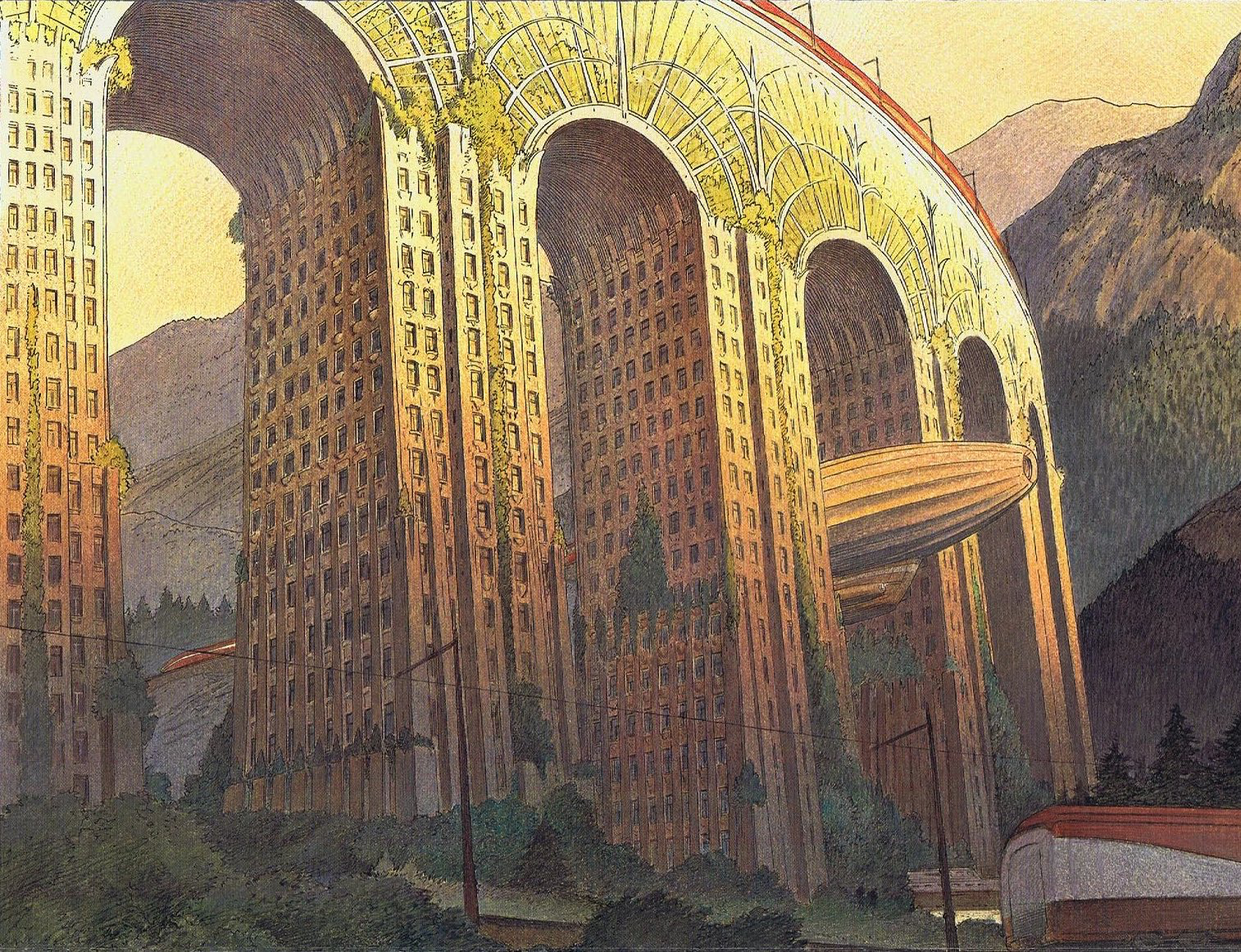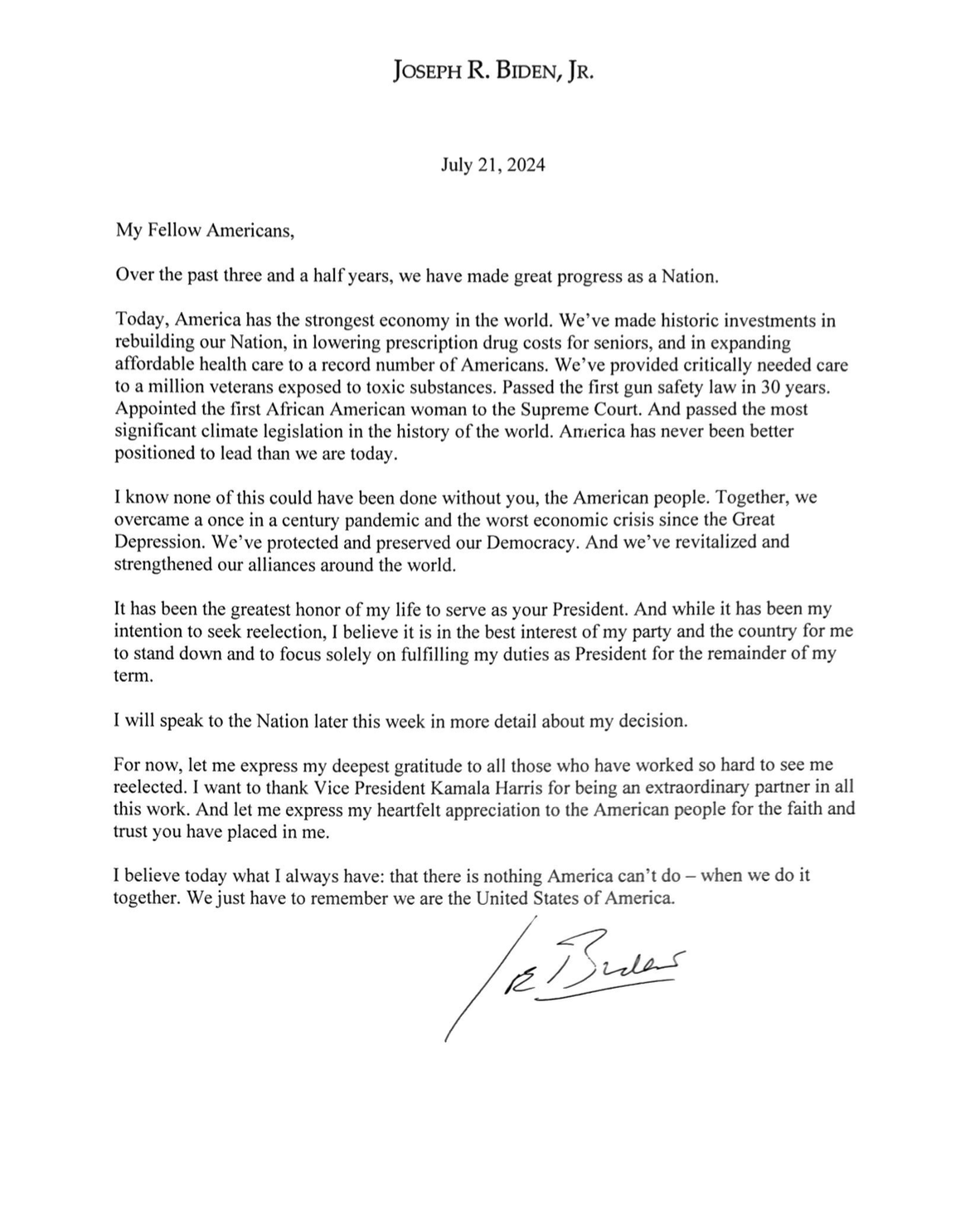Au Bangladesh, les quotas de la colère
Malgré la répression qui a fait au moins 163 morts, le mouvement étudiant contre les quotas d’embauche de fonctionnaires pourrait s’élargir à une contestation plus large de l’autoritarisme de la Première ministre, en poste depuis quinze ans.
par Nelly Didelot, publié aujourd'hui à 18h13
Pour vider les rues de Dacca des étudiants, si nombreux à manifester tous les jours depuis le début du mois de juillet, le gouvernement bangladais n’a reculé devant rien. Couvre-feu, coupure d’Internet, déploiement de l’armée dans les villes et une répression policière qui s’est faite sanglante depuis la semaine dernière.
Au moins 163 personnes sont mortes, parfois abattues à bout portant par les forces de l'ordre qui ont commencé à tirer à balle réelle. Jamais depuis au moins quinze ans, le Bangladesh n'avait traversé un épisode aussi violent. Aux racines du mouvement, au départ pacifique et porté par les étudiants, se trouve une disposition mise en place dès les premières heures de l'indépendance du Bangladesh : le système de quotas d'embauches des fonctionnaires.
Pourquoi ce système de quotas pose-t-il problème ?
Dans un pays placé par la Banque mondiale dans le dernier tiers du classement mondial en termes de PIB par habitant, les emplois de fonctionnaires stables, bien payés et dotés d'avantages sociaux sont très recherchés. Mais plus de la moitié d'entre eux (56 %) sont attribués selon des quotas depuis 1972 : 10 % doivent aller à des femmes, 10 % aux personnes vivant dans des districts sous-développés, 5 % à certaines communautés ethniques minoritaires et 1 % aux personnes atteintes d'un handicap. Les 30 % restants sont réservés aux descendants de ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Bangladesh en 1971, lors de la guerre contre le Pakistan. A l'époque, ces «combattants de la liberté» étaient environ 300 000. Aujourd'hui, le Bangladesh compte 171 millions d'habitants, dont environ la moitié a moins de 28 ans.
Ce sont ces postes réservés qui ont provoqué la fureur des étudiants. Réunis au sein du collectif Students Against Discrimination, ils réclament que ces quotas soient abrogés, à l'exception de ceux en faveur des minorités ethniques et des personnes handicapées (soit 6 % des postes). Les autres devraient être attribués uniquement au mérite. Aujourd'hui, selon les étudiants contestataires, le système est utilisé de manière abusive pour permettre aux partisans du parti au pouvoir depuis quinze ans, la Ligue Awami, d'occuper des postes de fonctionnaire.
Pourquoi les manifestations ont-elles éclaté cet été et pourquoi ont-elles pris une telle ampleur ?
Les raisons sont multiples, principalement juridiques mais aussi d'ordre économique. Le système de quotas de fonctionnaires avait été supprimé en 2018, déjà après d'importantes manifestations étudiantes. Mais en juin, la Haute Cour de Dacca l'a rétabli. Elle a tranché en faveur d'une demande déposée par sept descendants de vétérans de la guerre d'indépendance, qui réclamaient le retour du quota de 30 %. «Le rétablissement des quotas figurait dans le manifeste électoral de la Ligue Awami lors de sa quatrième victoire électorale consécutive en janvier. C'était une demande importante de ses soutiens traditionnels», pointe Olivier Guillard, chercheur à l'Institut d'études de géopolitique appliquée.
Pour les étudiants lambdas, le retour des quotas est d'autant plus inacceptable que le pays peine à offrir des emplois aux jeunes diplômés. Selon les statistiques gouvernementales sur l'année 2022, plus de 40 % des Bangladais âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi ou n'étudient pas, soit 18 millions de jeunes. La mainmise des étudiants proches de la Ligue Awami sur les meilleures places débute dès l'université. «Pendant plus d'une décennie, les étudiants affiliés au parti au pouvoir ont régné sur les campus universitaires, transformant les dortoirs en centres de recrutement pour la Ligue Awami, ou contraignant ceux qui y vivaient à rejoindre le parti», explique Ali Riaz, professeur de sciences politiques à l'université de l'Illinois, dans un article pour le média régional Benar News.
Entre les étudiants contestataires et ceux affiliés à la Chhatra League, la branche étudiante de la Ligue Awami, les tensions ont été vives ces dernières semaines, allant jusqu'à des affrontements rangés à coup de briques et de cannes en bambou. «Depuis au moins quinze ans et l'élection de la Ligue Awami, la polarisation est terrible entre le parti au pouvoir et l'opposition principalement incarnée par l'autre formation politique historique, le Bangladesh Nationalist Party (BNP). L'atmosphère politique est délétère et la violence partisane n'est jamais loin», explique Olivier Guillard.
Le parti au pouvoir, dont l'autoritarisme va croissant, tire toujours une part de sa légitimité de son histoire. Créé dès 1949, bien avant tous ses rivaux actuels, il a joué un rôle important lors de la guerre d'indépendance et continue à se considérer comme le garant de la souveraineté du pays. Sheikh Mujibur Rahman, le premier président bangladais et l'un des membres fondateurs de la Ligue Awami, est d'ailleurs le père de Sheikh Hasina, la Première ministre inamovible, réélue pour un quatrième mandat cette année, lors d'une élection boycottée par l'opposition. Les manifestations ont commencé à prendre un tour plus violent la semaine dernière, avec l'incendie de bâtiments gouvernementaux, après qu'elle a qualifié les opposants aux quotas de «razakars», un terme insultant qui désigne ceux qui ont collaboré avec le Pakistan pendant la lutte pour l'indépendance.
La contestation peut-elle aller au-delà des quotas ?
Depuis qu'Internet a été coupé, le 18 juillet, il est devenu plus difficile de savoir quelle est la situation sur le terrain. Ce lundi 22 juillet, les rues de la capitale semblaient être relativement calmes, vidées par les patrouilles de l'armée et le couvre-feu. Mais malgré la répression sanglante, les étudiants ont gagné une première manche. Dimanche, la Cour suprême a ordonné l'abaissement des quotas de fonctionnaires : 5 % des postes devraient rester réservés aux descendants des combattants de l'indépendance et 2 % aux autres catégories. Ce lundi, le mouvement Students Against Discrimination a annoncé suspendre les manifestations pour quarante-huit heures, tout en précisant qu'il n'abandonnait pas la lutte.
Le mouvement semble avoir dépassé la question des quotas. «L'arrêt de la Cour suprême ne mettra pas fin à la crise. Les manifestations se sont transformées en un mouvement antigouvernemental plus large qui s'appuie sur des griefs anciens», pointe Michael Kugelman, directeur de l'Institut de l'Asie du Sud au Wilson Center, sur X. Après la mort de dizaines d'étudiants désarmés, les cris «A bas la dictatrice» ont commencé à résonner dans les manifestations. «C'est la première fois que Sheikh Hasina est contestée directement depuis le début de ses quatre mandats consécutifs. Les gens critiquaient son parti et l'administration en général, mais il était tabou de remettre en question ses déclarations», note Ali Riaz. C'est également la première fois que Sheikh Hasina doit faire appel à l'armée pour ramener le calme.
La Première ministre, depuis longtemps surnommée «la Dame de fer», n'a pas pour autant perdu la main. La répression des manifestations a été l'occasion d'une nouvelle rafle contre les milieux d'opposition. Plus de 500 personnes ont été arrêtées ce week-end, dont des dirigeants du BNP, le rival historique de la Ligue Awami.